Nos Productions
De 1992 à aujourd’hui.
Nos productions de 1992 à aujourd'hui
Dès le départ, nous nous étions fixé pour objectif de proposer à de jeunes chanteurs une plate-forme qui leur permettrait de faire leurs premiers pas sur scène, entourés, conseillés et guidés par des professionnels déjà accomplis. Nous avons au fil des ans élargi notre palette et diversifié notre répertoire. Nous avons également présenté plusieurs productions d'opéra de Mozart : Don Juan et les Noces de Figaro. Les plaisirs lyriques ne pouvant s'arrêter aux plats principaux, nous avons monté quelques courts desserts tels que de petits opéras de Gluck, de Rossini... dont le Docteur Miracle de Bizet... Notre troupe s'est enrichie de solides maillons au fil des productions, avec des artistes de grandes qualités vocales et scénique, perfectionnés chez de grands maitres de l'art lyrique. Certains sont lauréats de divers concours internationaux.
La Compagnie Lyrique
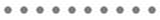
- 2013
La Périchole
La Périchole
juillet 5, 2013 - 2012
La Vie Parisienne
La Vie Parisienne
juillet 5, 2012
Offenbach compose « La Vie Parisienne » sur un livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy : l’opéra-bouffe est jouée pour la première fois le 31 octobre 1866 au théâtre du Palais Royal. La pièce tiendra l’affiche pendant un an, un record à l’époque, avant d’avoir la carrière triomphale que l’on connaît. L’œuvre est un miroir de la société parisienne à la veille de l’Exposition universelle de 1867.
- 2009
Gianni Schicchi
Gianni Schicchi
juillet 15, 2009 - 2008
Little Opera
Little Opera
juillet 15, 2008 - 2007
A Night at the opera
A Night at the opera
juillet 15, 2007 - 2005
L’Inganno Felice
L’Inganno Felice
juillet 14, 2005 - 2003
Semaine de la Musique Russe
Semaine de la Musique Russe
juillet 14, 2003 - 2003
Angélique
Angélique
juillet 4, 2003 - 2003
La Scala de Seta
La Scala de Seta
juillet 1, 2003 - 2002
L’Ivrogne Corrigé
L’Ivrogne Corrigé
mai 4, 2002Opéra en un act de Christoph Willibald Gluck
L’Ivrogne Corrigé est l’un des douze opéras que Gluck a composés en français pour le Théâtre Français de Vienne dont il était directeur artistique. Tout comme Le Cadi Dupé ou Le Monde Renversé, il s’agit d’une œuvre courte (moins d’une heure) et très gaie. La musique, qui se veut par moment parodique (comme dans le chœur funèbre du deuxième acte qui fait penser à une cantate de Bach) n’en est pas moins superbe et la partition est parmi les meilleures composées par Gluck. Une des originalités de l’œuvre réside dans les caractéristiques vocales des personnages, le rôle du jeune amoureux Cléon étant chanté par un baryton alors que l’oncle ivrogne est, lui, chanté par un ténor.
L’histoire est celle de Mathurin, qui serait un brave homme s’il ne passait pas le plus clair de son temps à battre son épouse Mathurine et surtout à se saoûler chez lui ou à la taverne en compagnie de son voisin Lucas. Mathurin souhaiterait donner à Lucas, en gage d’amitié, la main de sa nièce Colette mais celle-ci est amoureuse de Cléon. Ce dernier, avec la complicité de Colette et de Mathurine, a mis au point un plan pour guérir Mathurin de ses travers. Alors que Mathurin et Lucas rentrent ivres morts de la taverne, Cléon et ses amis les installent dans une cave aménagée afin de leur faire croire qu’ils sont morts et tombés en enfer. C’est Cléon lui-même qui joue le rôle de Pluton, roi des enfers. Lucas et Mathurin sont fort impressionnés et, lorsque Mathurine vient intercéder en faveur de son époux, celui-ci jure de renoncer au vin pour toujours et consent à donner sa nièce à Cléon. Quant à Lucas, une fois remis de ses frayeurs, il se console en buvant de plus belle.
L’ATLAS a représenté L’Ivrogne Corrigé pour la première fois à Genève en 2002, dans une version accompagnée au piano par Ludmilla Gautheron, et avec un petit chœur. La mise en scène était signée Antoine Bernheim. La version proposée est celle sans entracte, le changement de décor entre la salle de séjour de Mathurin et la cave où lui et Lucas sont transportés se faisant rapidement et sous les yeux du public par les différents comédiens appelés à être dans la pièce les démons de l’enfer.
- 2002
Il Signor Bruschino
Il Signor Bruschino
avril 4, 2002 - 2001
Des Crinolines aux Paillettes
Des Crinolines aux Paillettes
juillet 15, 2001 - 2000
Les Noces de Figaro
Les Noces de Figaro
juillet 4, 2000Le Nozze di Figaro
Opéra en 4 actes de Wolfgang Amadeus MOZART
La révolution est en marche…
Lorsque Mozart un génie de la musique s’associe à un génie du théatre, Da Ponte, pour adapter une pièce géniale, Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais, cela ne peut que donner un chef d’œuvre.
Ces Noces de Figaropeuvent en effet être qualifiées de géniales, surtout lorsque l’on se rend compte de la maestria avec laquelle Mozart et Da Ponte ont dupé la vigilante censure impériale autrichienne, en faisant passer dans la musique les idées révolutionnaires de Beaumarchais alors que le texte, lui, semblait beaucoup moins subversif. C’est ainsi qu’en lieu et place du célèbre monologue de Figaro au dernier acte de la pièce, Da Ponte écrivit un texte où Figaro se plaignait de l’infidélité des femmes, et Mozart le mit en musique via un air avec récitatif accompagné. Or, c’était la première fois dans l’histoire de l’opéra qu’un valet se voyait confier un air avec récitatif accompagné, genre jusque là réservé aux personnages nobles.
L’histoire se déroule dans le château du Comte Almaviva, grand d’Espagne, et noble volage qui, bien qu’ayant aboli le droit de cuissage, n’en a pas moins des vues sur la jolie Susanna, camériste de la Comtesse. Susanna est fiancée à Figaro, l’astucieux valet du Comte, qui est bien décidé à empêcher le Comte de parvenir à ses fins. Il va mettre au point un stratagème consistant à faire croire au Comte que Susanna accepte un rendez-vous nocturne avec lui, rendez-vous où elle sera suppléée par Cherubino, un page que l’on aura travesti en femme. Mais la ruse est éventée, et le Comte riposte en tentant de forcer Figaro à épouser la vieille Marcellina à qui il avait autrefois signé une promesse de mariage contre espèces sonnantes et trébuchantes. Heureusement, il s’avère que Figaro était l’enfant perdu que Marcellina avait eu jadis de Bartolo, l’ancien tuteur de la Comtesse. Entretemps, Susanna et la Comtesse ont repris à leur compte le plan de Figaro et l’ont amélioré : c’est la Comtesse elle-même qui se déguise en Susanna et va au rendez-vous fixé avec le Comte, avant de le confondre aux yeux de tous. Vaincu, le Comte pardonne à tous et Figaro peut enfin célébrer son mariage.
La Compagnie Lyrique de Genève a représenté le Nozze di Figaropour la première fois au Château de Coppet en 2000. La mise en scène était signée Elfriede John. Les chanteurs, en costumes d’époque, étaient accompagnés par un piano et un quintette à cordes placés sous la direction de Pascal Salomon, alors qu’un récitant, Georges Kleinmann assurait le lien entre les différents morceaux pour commenter l’action.
Figaro (Antoine Bernheim, au centre) ne craint pas l’affrontement verbal avec son maître, le Comte (Sacha Michon, à gauche). Susanna (Sophie Ellen Frank, tout à droite) et la Comtesse (Catherine Martinet) sont, quant à elles, complices et un brin espiègles.
texte de Sophie Ellen FRANK
Susanna (Sophie Ellen Frank) Figaro (Antoine Bernheim, à
s’évanouit dans les bras du Comte droite) explique au malheureux
(Sacha Michon, à droite) et de Don Cherubino (Joëlle Ambrosini
Basilio (Xan White, à gauche). à gauche) ce que sera sa nouvelle vie, à l’armée où le Comte l’a envoyé. - 2000
Le Cadi Dupé
Le Cadi Dupé
juillet 4, 2000Opéra en 1 acte de Christoph Willibald GLUCK
Le Cadi Dupé est un opéra que Gluck a composé en 1762 (la même année qu’Orphée) pour le Théâtre Français de Vienne. Le livret de P.R. Lemonier avait déjà été mis en musique par le compositeur français Monsigny, mais Gluck, censé réorchestrer l’œuvre de Monsigny, recomposa pour l’occasion une musique tout à fait nouvelle. Ce charmant divertissement en un acte (d’une durée approximative de cinquante minutes) est en fait un vaudeville classique, doublé d’une turquerie, genre dont les spectateurs viennois du XVIIIème siècle étaient friands. L’orchestration de l’œuvre n’est pas sans rappeler celle d’une des plus célèbres turqueries du XVIIIème siècle, l’Enlèvement au Sérail de Mozart.
- 1998
Le Docteur Miracle
Le Docteur Miracle
juillet 4, 1998 - 1998
Vivat Bacchus
Vivat Bacchus
juillet 4, 1998 - 1997
Cambiale di Matrimonio
Cambiale di Matrimonio
juillet 16, 1997 - 1997
Vocaline
Vocaline
juillet 15, 1997 - 1997
Musique en Fête
Musique en Fête
juillet 4, 1997 - 1996
Don Giovanni
Don Giovanni
juillet 4, 1996
Les grands Mozart
Opéra en 2 actes de Wolfgang Amadeus MOZART
Pour beaucoup de musicologues, Don Giovanni est considéré comme l’opéra “roi”. Qu’il soit un chef d’œuvre absolu ne constitue en tout cas pas le moindre doute, tant on se rend compte que tout, absolument tout l’opéra est contenu dans ces deux actes : la comédie, le drame, le lyrisme, l’action, la parodie et surtout une musique considérée comme fort moderne à l’époque (l’entrée de la Statue du Commandeur n’est-elle pas le tout premier exemple de dodécaphonie dans l’histoire de l’opéra ?) et qui sait transporter l’auditeur comme seule la musique de Mozart sait le faire.
L’histoire, qui avait déjà inspiré nombre d’auteurs dont Molière, est celle de Don Giovanni (ou Don Juan), un jeune noble libertin qui voyage à travers l’Europe pour assouvir son insatiable appétit pour les conquêtes féminines. Au moment où débute l’opéra, Don Giovanni a réussi à s’introduire dans la chambre de Donna Anna, mais celle-ci appelle à l’aide et son père, le Commandeur, accourt à son secours et provoque Don Giovanni en duel.
Don Giovanni tue le Commandeur, et s’en va avant l’arrivée de Don Ottavio, le fiancé de Donna Anna qui jure de venger la mort du Commandeur. Entretemps, Don Giovanni est reparti pour de nouvelles conquêtes mais tombe par malchance sur une de ses anciennes promises, Donna Elvira, qui le cherchait pour le ramener à elle.
Apprenant de la bouche du valet de Don Giovanni, Leporello, qui est vraiment l’homme qu’elle aimait, Donna Elvira décide d’empêcher Don Giovanni de continuer à nuire. Elle va tout d’abord arracher des griffes du libertin la paysanne Zerlina, qu’il avait réussi à séduire le jour de son mariage avec le paysan Masetto et à faire comprendre à Don Ottavio et à Donna Anna que l’assassin du père de cette dernière était en fait Don Giovanni.
Celui-ci, attaqué de toutes parts, fera face mais ne pourra rien lorsque la Statue du Commandeur viendra le chercher pour l’envoyer en enfer, pour le plus grand soulagement de tous.

Don Giovanni (Hugues Georges)
Zerlina (Claire Tièche)« La ci darem la mano »
L’ATLAS a représenté Don Giovanni pour la première fois à Genève en 1996, dans une version accompagnée au piano et expurgée de la plupart des récitatifs avec le récitant Georges Kleinmann qui faisait le lien entre les scènes. La reprise, à Lyon, en 1998 était, elle, intégrale et avec un quintette à corde pour accompagnement. La mise en scène était signée Elfriede John.
- 1993
Gloria Sepharadica
Gloria Sepharadica
juillet 15, 1993 - 1992
Compagnie
Compagnie
juillet 15, 1992 - 1992
Compagnie Lyrique de Genève
Compagnie Lyrique de Genève
juillet 15, 1992


